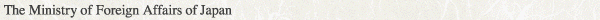
Discours du Premier Ministre Mori sur la politique africaine du Japon
(traduction provisoire)
« L'Afrique et le Japon dans le nouveau siècle »
Le 9 janvier 2001
(Introduction)
Monsieur le Président Mbeki, Monsieur le Vice-Président Zuma, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs,
Je suis extrêmement heureux d'être enfin en Afrique, et de commencer mon voyage dans votre pays, l'Afrique du Sud, qui a gagné le combat pour les droits de l'homme, et qui détient la clef du succès de la renaissance africaine. Je voudrais remercier Monsieur le Président Mbeki pour son chaleureux discours de bienvenue qui m'a profondément touché.
Si j'ai, en tant que Premier Ministre japonais, choisi l'Afrique subsaharienne comme destination du premier voyage officiel du siècle qui vient de s'ouvrir, j'avais de bonnes raisons.
Au mois de juillet de l'an passé, j'ai, en tant que président du Sommet du G8, pris l'initiative d'inviter, pour que se réalise un dialogue au sommet entre les pays du G8 et les pays en voie de développement, trois présidents africains. J'ai pu ainsi avoir des entretiens approfondis avec Monsieur le Président Mbeki, Monsieur le Président Obasanjo, et Monsieur le Président Bouteflika. La très forte détermination et la puissante passion avec lesquelles les trois présidents font face aux difficultés du moment, m'ont très fortement et favorablement impressionné.
Il se trouve que parallèlement à ces rencontres, j'ai reçu dans ma résidence une invitée de marque : Madame Ogata Sadako, ancienne Haut Commissaire aux Réfugiés de l'Organisation des Nations Unies, qui est ici avec nous. Madame Ogata qui a effectué, pendant ses mandats, trente-et-une visites de terrain en Afrique, m'a informé de manière très détaillée de la tragédie que constituent les conflits qui sont à l'origine du problème des réfugiés, mais également des avancées concrètes que les Africains sont en train d'effectuer pour la résolution par eux-mêmes de ces conflits.
Mes dialogues aves les trois présidents africains se sont poursuivis au Sommet du Millénaire de l'ONU en septembre 2000. Et grâce à cette série de dialogues, j'ai été conforté dans ma conviction que « le 21ème siècle sera le siècle où l'Afrique accomplira un grand bond en avant » et que « le monde du 21ème siècle ne connaîtra la stabilité et la prospérité que si les problèmes de l'Afrique sont résolus ». J'ai été pris par l'envie de venir en Afrique pour dire de vive voix à mes amis africains combien le Japon est déterminé à réfléchir, faire tous les efforts possibles et mettre en œuvre tout son potentiel, ensemble avec les pays africains, pour que l'Afrique parvienne à surmonter ses difficultés actuelles et à progresser sur le chemin d'un avenir brillant. Ainsi, ai-je pensé, la diplomatie japonaise trouvera un nouveau départ qui lui donnera une dimension véritablement globale. Et c'est cela qui m'a amené à choisir l'Afrique comme destination de mon premier voyage du nouveau siècle.
(Le monde du 21ème siècle ne connaîtra la stabilité et la prospérité que si les problèmes de l'Afrique sont résolus)
L'Afrique, qui a longtemps souffert de l'héritage négatif de l'Histoire, continue aujourd'hui, à faire face à des problèmes difficiles.
Le niveau du PIB par habitant en Afrique était autrefois le plus élevé des régions en voie de développement. Mais dans les années soixante-dix, le PIB africain a malheureusement connu une régression, descendant à six cents dollars pour baisser jusqu'à cinq cent dix dollars dans les années quatre-vingt-dix, et ce alors que les autres régions en voie de développement connaissaient une croissance rapide.
Après la fin de la Guerre froide, pendant les années quatre-vingt-dix, les conflits en Afrique ont connu une augmentation notable. Selon le Haut Commissariat aux Réfugiés, une personne sur cinq en Afrique est aujourd'hui victime d'un conflit, et le nombre total de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et de réfugiés atteindrait six millions deux cent cinquante mille. Le monde entier est rempli de tristesse par cette situation. Il est également urgent de sauver les populations africains, la ressource vive et la richesse du continent, de la propagations des maladies infectieuses telles que le Sida.
Les difficultés auxquelles l'Afrique est confrontée ne sont certes pas faciles à résoudre. Mais je continue à croire en un avenir brillant pour l'Afrique. La réalité est indéniablement difficile, mais je perçois la forte pulsation de la marche vers la Renaissance africaine, telle que la propose le président Mbeki. Les difficultés économiques subsistent, mais la Banque Mondiale prévoit, dans une projection à moyen terme, jusqu'en 2003, une croissance annuelle moyenne supérieure à 5 % pour vingt-sept des quarante-sept pays de l'Afrique subsaharienne. Voilà une perspective positive. Nous sommes encouragés de voir que les efforts des Africains eux-mêmes pour la résolution des conflits commencent à avoir des résultats concrets comme le montrent par exemple l'accord de paix signé au Burundi grâce à la médiation du Président Mandela ou encore l'accord de cessez-le-feu négocié entre l'Ethiopie et l'Erythrée par l'intermédiaire de l'OUA. La lutte contre les maladies infectieuses en est tout juste à ses débuts, mais dans certains pays, on constate déjà des résultats concrets concernant la baisse de la morbidité :
Je vous ai dit que « le 21ème siècle sera le siècle où l'Afrique accomplira un grand bond en avant ». L'Afrique est, c'est inutile de le répéter, riche de grands atouts naturels et de ressources humaines dynamiques. Ce continent à la riche histoire renferme un potentiel illimité pour l'avenir. Au 8ème siècle, alors qu'en Europe, le royaume des Francs posait les premières bases d'un Etat centralisé, en Afrique le Royaume du Ghana prospérait. Et au 14ème siècle, alors que l'Empire de Songhaï a succédé au Royaume de Mali, sa capitale, la cité de Tombouctou, était non seulement un centre d'échanges économiques mais également un centre de savoir prospère où, dit-on, il y avait plus de professeurs et d'étudiants que n'en avait l'université de la Sorbonne à Paris. Et j'ai appris qu'à la même époque, votre région, le sud-est de l'Afrique, exportait du fer vers l'Empire indien par l'intermédiaire des marchands indonésiens qui traversaient l'Océan Indien.
Alors que la mondialisation rapproche de plus en plus l'ensemble des régions de la Terre, on ne peut plus parler du « monde de demain » sans tenir compte de l'Afrique subsaharienne qui représente 20 % de la surface terrestre et 10 % de la population mondiale. L'Afrique, si elle parvient à surmonter les difficultés qu'elle connaît aujourd'hui et qu'elle s'engage sur le chemin d'un avenir brillant, devrait être une locomotive de développement pour l'ensemble de la société humaine du 21ème siècle. Comme l'a dit si justement le Président Mbeki, citant Pline l'Ancien, « Tout ce qui est nouveau vient toujours de l'Afrique ». A contrario, la prospérité et la stabilité de la communauté mondiale ne sauront se réaliser si les problèmes africains restent sans solution et que le quart des membres du monde est exclu. En effet, « Le monde du 21ème siècle ne connaîtra la stabilité et la prospérité que si les problèmes de l'Afrique sont résolus. »
( L'engagement déterminé du Japon face aux problèmes africains )
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Les premiers contacts entre l'Afrique et le Japon remontent à 1586, pendant l'ère Tenshô du calendrier japonais. Des documents écrits relatent qu'une mission de jeunes Japonais, après avoir visité l'Europe et notamment le Vatican, séjourna au Mozambique pendant six mois, suite à des orages qui les empêchaient de regagner le Japon via le Cap de Bonne-Espérance. Mais la décision japonaise ultérieure de couper tout contact avec l'étranger mit fin à ces relations. Puis, en 1918, le Japon ouvrit son premier consulat en Afrique subsaharienne, dans la ville du Cap et en 1927, le docteur Noguchi Hideyo, qui consacra sa vie à l'étude de la fièvre jaune, mourut au Ghana. Mais hormis ces quelques épisodes, les échanges bilatéraux réguliers ne commencèrent véritablement qu'après la fin de la deuxième guerre mondiale alors que les pays africains recouvraient leur indépendance, ce qui veut dire que nos relations ont moins de cinquante ans d'histoire.
Mais le Japon n'a cessé de renforcer graduellement son engagement vis-à-vis de l'Afrique. À l'aube du nouveau siècle, je réaffirme solennellement l'engagement inébranlable de notre pays vis-à-vis de l'Afrique, qui détient la clef de l'avenir de l'humanité. Le Japon a affirmé à plusieurs reprises sa détermination à contribuer, en tant que membre responsable de la communauté internationale, à la stabilité et à la prospérité du monde. Je considère que nos engagements vis-à-vis de l'Afrique constituent un des dossiers les plus importants pour la diplomatie de notre pays que nous voulons globale.
« Les deux axes de la coopération avec l'Afrique »
Afin de promouvoir la coopération avec l'Afrique, le Japon considère que les deux axes essentiels de sa politique sont d'une part l'aide au développement, et d'autre part les actions pour la prévention des conflits et en faveur des réfugiés.
Avant de présenter chacun de ces programmes, je souhaiterais tout d'abord vous parler de la philosophie qui sous-tend notre coopération avec l'Afrique. Les graves problèmes qu'affronte l'Afrique, la pauvreté, les conflits, les réfugiés, les maladies infectieuses, les ressources en eau, et la destruction de l'environnement, sont autant de menaces pour l'existence même du genre humain. Nous croyons qu'au 21ème siècle, notre diplomatie en faveur de la paix doit avoir pour thème « la sécurité humaine ». Dans ce sens, il n'est pas exagéré de dire que le succès ou l'échec de notre coopération avec l'Afrique pour y assurer « la sécurité humaine », constituera un test important pour le fondement même de notre diplomatie. Notre politique pour la sécurité humaine est basée sur une idée simple, celle que chaque être humain doit recevoir le maximum d'égards, et nous sommes convaincus que l'éducation et la formation des hommes et des femmes constituent un des enjeux majeurs pour que l'humanité surmonte à moyen et à long terme les différentes menaces auxquelles elle fait face.
Le Japon qui ne dispose pas de ressources naturelles a trouvé dans le capital humain son unique ressource et c'est ce qui nous a conduit à toujours mettre l'accent sur l'éducation. Nous avons en effet une conviction optimiste : le développement des talents et la coopération entre les hommes peuvent nous permettre de surmonter toutes les difficultés. Cet optimisme explique la manière dont nous envisageons nos actions de coopération. Nous pensons en effet qu'afin d'agir avec nos partenaires et d'éviter le piège de la charité, nous devons toujours voir les choses comme ils les voient.
J'aimerais maintenant vous parler des deux axes de notre politique qui doivent s'articuler avec cohérence, le premier étant l'aide au développement et le second, les actions pour la prévention des conflits et en faveur des réfugiés. Seule la maturité de la démocratie rend possible d'éviter les conflits en choisissant le dialogue et non la force, et seul le développement économique permet la maturité de la démocratie. Pour réaliser cela, tant les efforts des personnes directement concernées que des coopérations extérieures, comme le sont les cadres politiques assurant la sécurité ou encore un système d'aide internationale visant à éliminer la pauvreté, sont indispensables. Mais la réalité est qu'une telle prévention des conflits reste insuffisante et que l'on continue à voir l'accroissement du nombre de réfugiés. Afin de résoudre fondamentalement le problème des réfugiés, il faut naturellement une résolution politique des conflits qui en sont à l'origine, et dans la pratique de l'aide aux réfugiés, il faut trouver une réponse au défi que constitue la mise en place harmonieuse de l'aide humanitaire d'urgence et de l'aide au développement. C'était cette difficulté que Madame Ogata, ancien Haut Commissaire aux Réfugiés, a dû essayer de surmonter pendant qu'elle dirigeait les programmes d'aides aux réfugiés. Le Japon entend contribuer aux efforts qui ont pour objectif une solidarité étroite entre l'aide aux réfugiés et l'aide au développement pour que les organisations internationales, les gouvernement, les organisations non-gouvernementales et des autres qui ont des responsabilités dans les différents domaines de la politique, la sécurité, l'humanitaire, et le développement puissent construire une bonne relation de coopération.
Je souhaiterais maintenant aborder l'orientation de notre politique d'aide au développement en faveur de l'Afrique.
L'aide au développement demeure comme par dans le passé un des outils essentiels de la politique africaine de notre pays. Le Japon a organisé, en 1993 et en 1998, la Conférence Internationale pour le Développement de l'Afrique (TICAD). Sur la base de ces acquis, nous souhaitons, à terme, organiser la troisième Conférence pour le Développement de l'Afrique (TICAD III). Et j'aimerais ici vous proposer l'organisation en décembre de cette année d'une réunion ministérielle sur le développement de l'Afrique à Tokyo pour la préparation de la TICAD III.
D'ores et déjà, nous avons pu élaborer, à travers le processus de la TICAD, un consensus sur les orientations fondamentales de nos efforts : une approche globale comprenant la garantie de la stabilité politique, l'appropriation (ownership) des Africains et le partenariat de la communauté internationale, ainsi que la promotion des coopérations Sud-Sud. Sur la base de ces orientations fondamentales, les priorités de notre gouvernement sur le processus à venir de la TICAD sont les trois points que je vais m'efforcer de vous décrire, et pour lesquels je souhaiterais obtenir vos commentaires et ceux des autres pays africains.
La première priorité est que la Conférence TICAD devienne le forum privilégié où les Africains peuvent parler des stratégies de développement élaborées par eux-mêmes. Il est certes intéressant de discuter des initiatives africaines pour l'exécution des programmes de développement. Mais l'appropriation (ownership) ne deviendra une réalité que si les idées africaines sont explicitées dès la phase de l'élaboration de la stratégie de développement. Et nous nous réjouissons du « Programme de Renaissance Africaine » proposé par le Président Mbeki, ainsi que de l'initiative des pays africains actuellement en cours d'élaboration intitulée « Programme de Développement Africain » qui s'en inspire. Le gouvernement japonais a l'intention, avec les autres pays partenaires, d'accorder la plus grande attention à ces stratégies de développement mises au point par les Africains eux-mêmes, et de discuter avec eux de leur mise en œuvre.
Le deuxième point est la poursuite de la coopération Sud-Sud. Il est important que l'expérience de développement du Japon et d'autres pays de l'Asie soient compris par les Africains. Cela peut s'envisager non seulement entre l'Asie et l'Afrique mais aussi entre les pays de l'Afrique du Nord et les pays subsahariens, ou encore entre d'autres régions du monde. Le projet de "Institut africain pour le développement de la formation" déployé à l'Université Jomo Kenyatta d'agriculture et de technologie (Jomo Kenyatta University College of Agriculture and Technology) au Kenya , à laquelle le Japon apporte son concours depuis vingt ans, en est un exemple.
Nous avons aujourd'hui besoin d'une approche globale dans tous les domaines de coopération, y compris les échanges dans le secteur privé. Nous disposons déjà de divers cadres de dialogue politique dont le Forum Asie Afrique, mais ce qui est à présent nécessaire est la matière grise, capable de définir une stratégie globale dans une perspective plus large. N'est-il pas temps d'envisager sérieusement la création d'un nouveau Forum que serait une « Conférence des Sages de l'Asie et de l'Afrique », composée de leaders intellectuels des deux régions ?
Le troisième point est le développement de la coopération dans la lutte contre le Sida et les autres maladies infectieuses, ainsi que dans le domaine des technologies de l'information. Notre pays a déjà entrepris l'application des priorités définies dans le Programme d'action Tokyo adopté lors de la TICAD II dans les domaines de l'éducation, de l'hygiène, de la santé publique et de l'approvisionnement en eau, en fournissant un don de quatre-vingt-dix milliards de yens sur cinq ans. Nous allons désormais étendre nos Actions prioritaires à la fois vers la lutte contre le Sida et les autres maladies infectieuses et vers la coopération dans le domaine des technologies de l'information.
En ce qui concerne la lutte contre les maladies infectieuses comme le Sida, la tuberculose et la malaria, nous nous sommes engagés à affecter trois milliards de dollars d'ici cinq ans dans « l'Initiative d'Okinawa pour la lutte contre les maladies infectieuses » prise lors du Sommet du G8. Ces fonds vont être activement utilisés en Afrique. Concrètement, nous allons par exemple participer aux actions de prévention et de diminution du Sida dans l'Etat de Kwazulu-Natal en Afrique du Sud. Une des méthodes les plus efficaces sera d'élargir les réseaux de coopération entre différents pays d'Afrique à partir des centres de recherche en coopération situés dans des pays comme le Kenya, le Ghana ou la Zambie. Lors de la « Conférence d'Okinawa pour la lutte contre les maladies infectieuses » qui s'est tenue à Okinawa en décembre dernier, Monsieur Chiluba, Président de la Zambie, nous a donné un discours d'orientation générale, et nous allons envoyer des missions d'études de haut niveau dans les pays concernés dès le début de cette année afin d'intensifier notre collaboration avec l'Afrique sur ce problème.
En ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication, leur diffusion est un moyen efficace pour remédier à la fracture dans le développement économique, et les pays africains eux-mêmes ont déjà pris des initiatives dans ce domaine. Le Japon a annoncé, lors du sommet de Kyushu-Okinawa un plan de coopération pour les technologies de l'information de quinze milliards de dollars d'ici cinq ans qui concerne le monde entier, et pour le mettre en œuvre, nous allons envoyer rapidement les missions d'études de haut niveau pour entamer des consultations avec des pays concernés sur des possibilités de coopération.
L'autre problème qui est important pour le développement est celui de la dette. A cet égard, une des priorités doit être de poursuivre aussi rapidement et efficacement que possible les efforts d'allègement de la dette des pays pauvres très endettés, ce qui ne manquera pas de les remettre sur la voie du développement social et de la réduction de la pauvreté. A la fin de l'année passée, des mesures d'allégement de la dette avaient déjà été prises envers vingt-deux pays pauvres très endettés et les efforts financiers du Japon en faveur de ces pays atteignent 3,8 milliards de dollars, le montant le plus important de tous les pays de G8.
Je vais présenter maintenant les actions de prévention des conflits et de soutien aux réfugiés, un des deux axes essentiels de notre coopération avec l'Afrique, l'autre étant l'aide au développement.
La coopération du Japon dans ce domaine a commencé à prendre corps avec la participation des observateurs japonais au groupe de surveillance de l'indépendance de la Namibie en 1989, donnant une forme tangible à ces deux axes. Notre contribution financière dans de nombreuses actions comme les aides aux réfugiés, le déminage, le financement du Fonds de la Paix de l'OUA et le soutien au processus de paix au Burundi, se monte à six cent millions de dollars depuis 1994.
Les causes de conflits en Afrique sont très complexes, résultant de l'héritage négatif de l'époque colonialiste, du sous-développement et de bien d'autres facteurs encore. Je suis cependant convaincu que tout conflit peut être mis sur la voie du règlement si les parties concernées s'y appliquent avec sagesse et détermination. L'histoire de l'Afrique du Sud où je me trouve aujourd'hui est une preuve éloquente du fait que les Africains possèdent la sagesse nécessaire pour surmonter les hostilités, si violents soient elles.
Permettez-moi de rappeler que le Japon, soucieux de la nécessité de trouver des règlements aux conflits sur le continent africain, soutient activement les efforts pour la paix des parties concernées, à travers des prises de contact de haut niveau comme nous l'avons fait à l'occasion de la TICAD II de 1998. Nous allons continuer nos efforts pour faire prendre conscience aux parties concernées que la pérennisation des conflits n'est rien de moins qu'un gaspillage permanent de ces ressources irremplaçables que sont les hommes.
Il demeure néanmoins évident qu'il est plus facile, et moins coûteux, de prévenir les conflits et d'en empêcher la reprise que de mettre fin à des confits en cours. C'est sur la base de ce constat que nous avons lancé « l'initiative de Miyazaki du G8 pour la prévention des conflits », que nous accordons l'importance à nos aides aux réfugiés, que nous finançons à hauteur de 20 % les actions du maintien de la paix des Nations Unies, et que nous avons envoyé nos forces d'auto-défense au Mozambique et au Rwanda.
La nomination de Madame Ogata Sadako en 1991 au poste de Haut-Commissaire aux Réfugiés des Nations Unies a coïncidé avec la prise de conscience des Japonais du problème des réfugiés dans le monde. Les actions de soutien aux réfugiés constituent en effet le noyau de nos actions pour le règlement de conflits en Afrique. Cette orientation se traduit clairement par l'augmentation du nombre d'ONG japonaises participant aux actions de soutien aux réfugiés et aussi par le fait, que j'ai mentionné précédemment, que la moitié de notre contribution financière en faveur des règlements de conflits en Afrique, soit un montant de trois cent mille dollars, est affectée à l'aide aux réfugiés. Je vais visiter moi-même un camp de réfugiés au Kenya au cours de ce voyage en Afrique. Ce que j'aurai appris pendant cette visite en Afrique sera bien mis à profit dans la définition de notre politique future.
Le Japon a reconstruit un pays que la Guerre du Pacifique avait totalement ruiné. Les Japonais, totalement désemparés pendant un moment, se sont remis aux travaux de la construction d'une nouvelle nation et ont réussi à réaliser le développement économique que nous connaissons. Ma génération est précisément celle qui a été le pilier de cette reconstruction d'après-guerre. Cette expérience personnelle ne me fait sentir que de façon plus aiguë l'importance de la réinsertion sociale de ces populations, réfugiés ou anciens combattants, et de leur engagement dans ce processus du renouveau du pays, car c'est ainsi que le travail de prévention et de règlement des conflits se rejoint organiquement au travail pour le développement.
Dans cette optique, nous avons organisé, il y a à peu près deux mois un « Groupe de travail / Symposium international sur les enfants et les conflits armés-Réinsertion des anciens enfants-soldats dans la communauté de l'après-conflit ». Nous avons également engagé une coopération en Sierrra-Léone pour la réinsertion des victimes de conflits.
(Le Japon et l'Afrique - un programme d'échanges de cœur à cœur)
Monsieur le Président , Mesdames et Messieurs
J'ai parlé jusqu'à présent principalement de notre coopération avec l'Afrique. Mais j'accorde une importance encore plus particulière aux échanges mutuels entre le Japon et l'Afrique. L'écrivain nigérian, Woyle Soyinka, lauréat du Prix Nobel de littérature, a déclaré, lors de sa visite au Japon en 1987 : « L'Afrique a toujours tenté une résistance efficace face à une culture en position de supériorité. Elle s'est toujours efforcée de percer un trou dans cet orgueilleux ballon et de l'éroder. Ce n'est qu'ainsi que la culture africaine a pu survivre sans être détruite ». Cette grande culture traditionnelle de l'Afrique, ses arts, sa pensée et aussi sa vie quotidienne, nous voulons mieux les connaître. Nous souhaitons recevoir des stimulations culturelles, comme autrefois Picasso ou Modigliani ont eu, en découvrant l'art africain, des révélations artistiques. Nous souhaitons également que le peuple africain comprenne mieux le Japon. Je suis convaincu que toutes nos actions politiques et économiques ne s'épanouiront sur un terrain de compréhension mutuelle et d'amitié que si les deux peuples ont des contacts de cœur à cœur.
Parler de la coopération entre le Japon et l'Afrique veut dire parler de la JOCV (Japan Overseas Cooperation Volunteers), dont les premiers volontaires sont venus au Kenya en 1965, et qui sont aujourd'hui présents dans dix-neuf pays de l'Afrique subsaharienne à commencer par l'Afrique du Sud avec laquelle a été conclu aujourd'hui même un nouvel accord d'envoi de mission. Dans le cadre de ce programme, près de sept cents jeunes Japonais travaillent à ce jour dans des pays africains. L'équipe féminine de volley-ball du Kenya qui a participé aux Jeux Olympiques de Sidney en tant que première équipe africaine dans cette discipline a comme entraîneur un jeune coopérant japonais. Un autre jeune Japonais s'attaque à la culture maraîchère dans un village du Niger. Le nombre des coopérants japonais envoyés en Afrique depuis le début du programme dépasse six mille.
Par ailleurs environ quatre cents étudiants africains sont inscrits actuellement dans des universités japonaises. Parmi ceux-ci, je cite d'abord deux coureurs de fond kenyans, John Kanyi et Francis Mwihia de l'Université Internationale de Heisei qui n'a que quatre années d'histoire depuis son établissement. Ils ont réalisé un grand exploit dans la traditionnelle course de relais de grand fond du Nouvel An. Monsieur Kanyi a réussi l'exploit de doubler huit coureurs concurrents sous le regard enthousiaste des spectateurs japonais. Ils ont ainsi rendu célèbre l'Université Internationale Heisei où ils font des études et ont aussi laissé une impression très forte de la présence africaine aux Japonais. L'Université Yamanashi Gakuin doit aussi sa renommée soudaine aux exploits de ses sportifs africains : elle voit augmenter le nombre de candidats à l'entrée. La vedette du marathon féminin des Jeux Olympique de Sydney, Esther Wamjiro, est une Kenyane qui après ses études au Japon, a choisi d'y rester pour travailler dans une entreprise japonaise. Nos étudiants africains ne manquent pas de talents dans des domaines très variés. Zamahoun Rufin, un Béninois qui rêve de fonder une école dans son pays natal, est un animateur de télévision très populaire au Japon. Ces étudiants africains apportent une stimulation bénéfique à la société japonaise et, après le retour au pays, par exemple en créant des « associations d'anciens étudiants au Japon » et forment le noyau des échanges culturels avec le Japon.
Ces jeunes Japonais et Africains qui ont chacun fait l'expérience de vivre dans le pays de l'autre sont un bien très précieux pour les échanges mutuels. Il est d'autant souhaitable d'élargir régulièrement cette assise des échanges que nous nous attendons à un essor spectaculaire des relations entre le Japon et de l'Afrique. Les domaines des échanges peuvent être très variés comme les échanges intellectuels, la coopération dans la recherche par exemple, ainsi que les échanges économiques privés ou le développement des activités touristiques. Je vais parler maintenant de deux de ces domaines auxquels j'attache beaucoup d'importance : les échanges culturels et les échanges entre les jeunes.
Saviez-vous qu'une chanteuse japonaise très connue au Japon, Tokiko Kato dont je suis moi-même un fan, a enregistré un disque dans votre pays et l'a commercialisé sous le titre de TokikoSky. Pour cet album, elle a composé ce poème : « L'Afrique où l'on dit que le premier être humain de cette planète a reçu la vie. Les élans du peuple qui se lève avec le soleil et qui a vécu avec le soleil sont partis vers le monde entier sous forme de nombreuses musiques : la samba du Brésil, le reggae des Caraïbes, le cha-cha-cha de Cuba, le fado du Portugal, le jazz de New York, etc. Tout trouve sa racine en Afrique, dit-on. Je n'oublierai jamais ces quelques semaines que j'ai vécu à chanter avec ces musiciens africains qui ont en eux-mêmes la musique comme destin. »
Entre le Japon et l'Afrique se font déjà des échanges de cœur à cœur de façon très naturelle. Je souhaite du fond du cœur que ces échanges se développent encore plus largement et plus profondément au niveau des peuples.
A l'occasion de la TICAD II en1998, une exposition sur l'art africain contemporain a été organisée au Japon avec un très grand succès.
Nous voudrions réaliser des événements similaires d'échanges culturels à chaque grande occasion comme lors de la prochaine TICAD III que nous envisageons d'organiser pour que tous les Japonais puissent se familiariser avec cette culture. Il est par ailleurs primordial de construire les réseaux de personnes qui deviendront le pivot de ces actions culturelles pour maintenir les échanges de haute qualité. Je propose de favoriser la création des programmes d'échanges entre les artistes ou ceux qui travaillent pour les musées et les théâtres.
La protection appropriée du patrimoine culturel, matériel ou immatériel, qui est un élément de l'enrichissement de nos échanges, est une autre priorité à laquelle le Japon est prêt à fournir une contribution active. Nous avons mené des actions de soutien à la protection du patrimoine en Asie par l'intermédiaire du Japan Trust Fund que nous avons mis en place au sein de l'UNESCO. Nous élargissons désormais son champ d'actions à l'Afrique et le programme de coopération pour la conservation et la restauration du Palais Royal du Bénin est en préparation. Il existe aussi en Afrique un important Patrimoine culturel immatériel comme la littérature orale, la musique traditionnelle ou la danse. Nos actions de soutien à la préservation de ces biens immatériels seront étendues également à l'Afrique. Enfin je voudrai aborder le point le plus important : la richesse de l'avenir des relations entre l'Afrique et le Japon dépend de la qualité de la compréhension mutuelle et de l'amitié entre les jeunes qui vont bâtir le 21ème siècle. Il existe différents programmes destinés aux échanges entre jeunes Japonais et jeunes Africains en particulier, tels que des programme de formation et de mission. Je me suis fixé comme objectif de réaliser des échanges entre six mille personnes d'ici trois ans, en utilisant activement ces programme :
(Conclusion)
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Dans un discours qu'il a donné lors de sa visite à l'Université des Nations Unies à Tokyo, le Président Mbeli a dit : « Toute l'humanité vit une relation d'interdépendance. Personne n'est libre tant que tous les hommes ne sont pas libres ; personne n'est vraiment riche que lorsque disparaissent de la terre les victimes de la famine ; la qualité de la vie n'est assurée que si tous les hommes s'engagent à préserver l'environnement. Le sous-développement de l'Afrique doit être la préoccupation de tout le monde ; la victoire de la renaissance de l'Afrique signifie que la dignité humaine regagne enfin l'humanité entière. »
J'ai signalé au début de mon discours d'aujourd'hui qu'il n'y aura ni stabilité ni prospérité dans le monde du XXIe siècle sans trouver une solution aux problèmes de l'Afrique. Comme l'a déclaré le Président Mbeki, il est impossible que toute l'humanité puisse jouir d'une vraie liberté et d'une vraie richesse et restaure sa dignité humaine sans renaissance de l'Afrique
Le Président Mbeki , après avoir affirmé dans le même discours que la renaissance de l'Afrique se réalisera uniquement quand les Africains eux-mêmes se seront fixé un but et un objectif clair, a encouragé ses auditeurs de Tokyo à participer au combat de l'Afrique pour sa renaissance.
Les Japonais ont répondu à l'appel du Président par un « oui » vigoureux
Je vous transmets ici cette réponse du peuple japonais. Combattons ensemble pour la renaissance de l'Afrique.
Je vous remercie de votre attention.